

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Maman Chercheuse… :https://www.youtube.com/@MamanChercheuse
… et au compte Instagram sur lequel vous trouverez un format résumé de chaque épisode: https://www.instagram.com/maman_chercheuse?igsh=MXYyYms1bzc2ZmprcA%3D%3D&utm_source=qr
Présentation des épisodes et des chercheuses
Ep. 1 : Les dendrimères : les taxis des médicaments
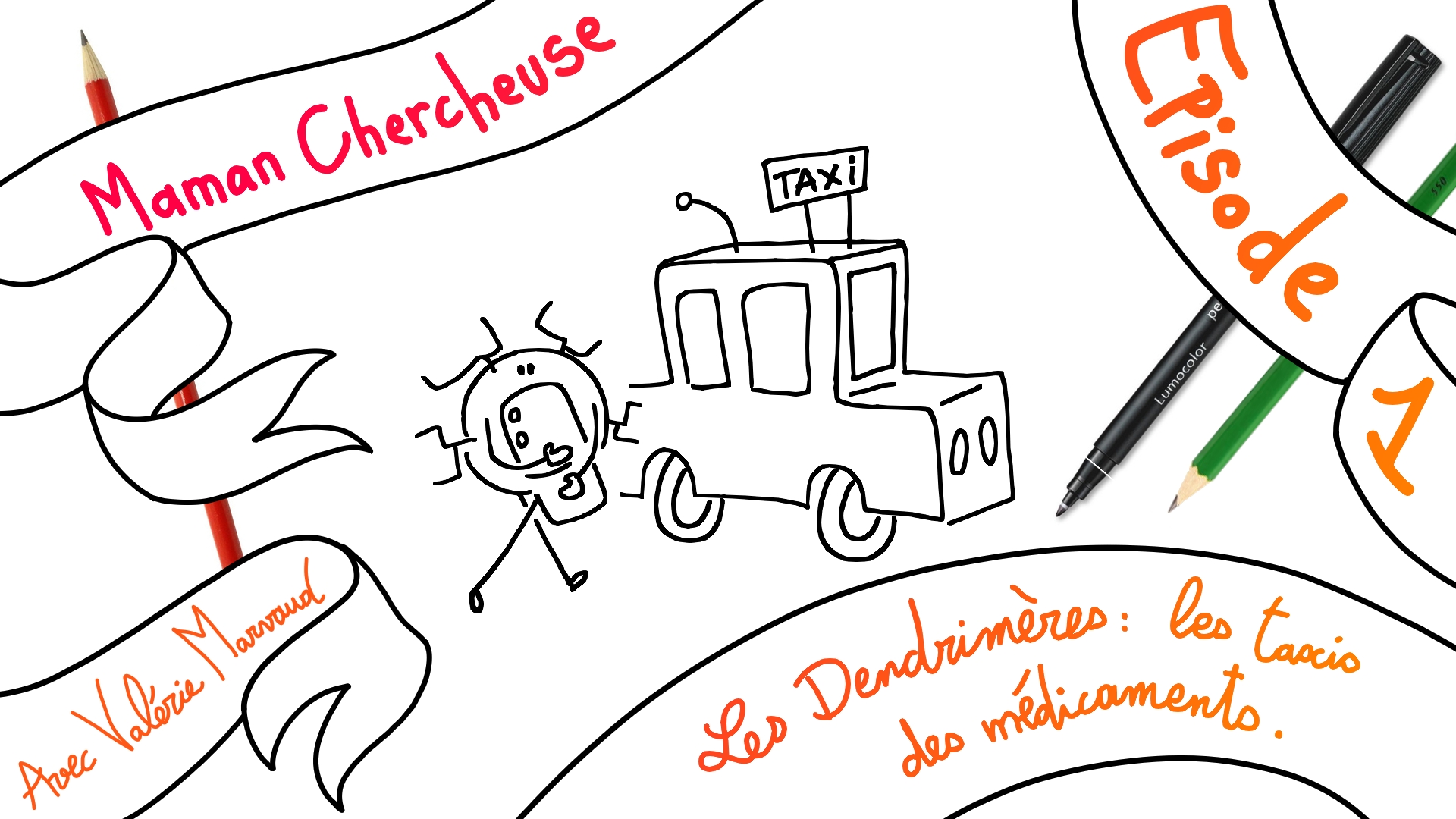
Les dendrimères sont de grosses molécules sphériques capables de transporter des médicaments anticancéreux jusqu’aux cellules malades. Contrairement à la chimiothérapie classique, qui peut aussi endommager des cellules saines, les dendrimères ciblent uniquement les cellules cancéreuses, ce qui rend le traitement plus précis et limite les effets secondaires.
Valérie Marvaud, CNRS, Sorbonne Université (IPCM)
Cet épisode a été réalisé avec Valérie Marvaud, directrice de recherche au CNRS à l’Institut Parisien de Chimie Moléculaire (Sorbonne Université). Elle travaille dans le domaine de la chimie inorganique supramoléculaire, en particulier la chimie de coordination avec la conception de composés hétéro-poly-métalliques. Ses thématiques de recherche portent sur les molécules à haut spin et les molécules-aimants, sur le photo-magnétisme, ainsi que sur les dendrimères magnétiques et les matériaux multifonctionnels.
Ep. 2 : Les fluorophores : les enquêteurs de la phagocytose

Les fluorophores sont des molécules fluorescentes qui servent à observer le comportement des cellules. Ils permettent notamment d’étudier comment les cellules immunitaires détruisent les bactéries, un processus appelé phagocytose. Quand les fluorophores se mettent à briller, cela montre que les cellules immunitaires ont bien avalé les bactéries.
Sophie Michelis, ENS-PSL (LBM)
Sophie Michelis est docteure en chimie moléculaire. Sa thèse, réalisée au Laboratoire des Biomolécules (Département de chimie, ENS-PSL) sous la direction de Blaise Dumat et Jean-Maurice Mallet (CNRS), portait sur le développement de gouttelettes fluorescentes pour l’étude de la phagocytose. L’équipe s’inscrit dans le domaine de la chimie-biologie, à l’interface entre chimie organique et imagerie cellulaire par fluorescence, et développe notamment des sondes fluorescentes pour visualiser et analyser des processus biologiques à l’échelle cellulaire.
Ep. 3 : Les microglies : les aspirateurs des rails
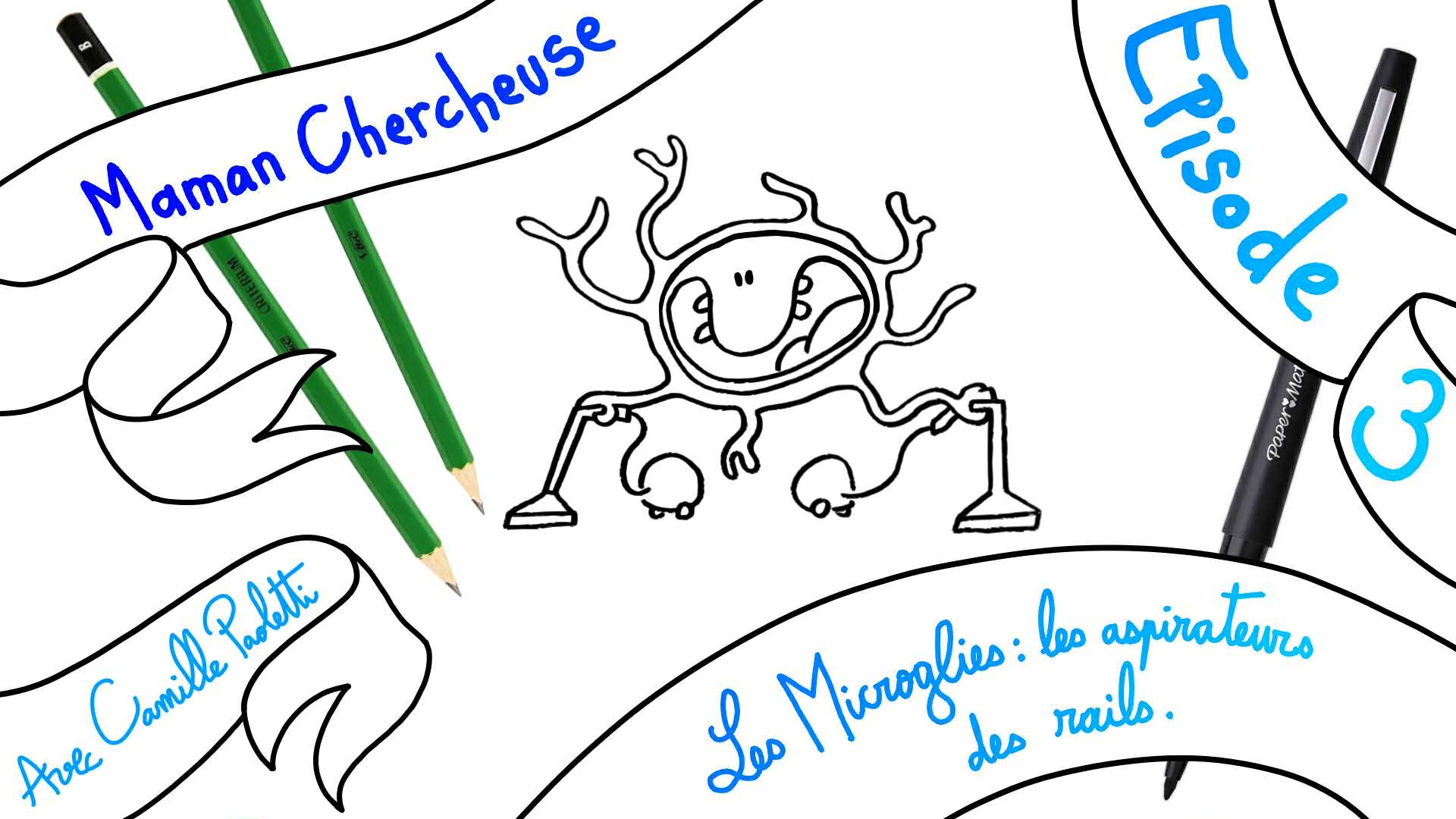
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative caractérisée, entre autres, par l’accumulation de déchets autour des neurones. Normalement, ces déchets sont éliminés par les cellules immunitaires du cerveau, appelées microglies, chargées du nettoyage. Mais avec l’âge, ces microglies deviennent moins efficaces, ce qui favorise l’accumulation de ces déchets.
Camille Paoletti, IBENS
Cet épisode a été réalisé avec Camille Paoletti, doctorante au sein du laboratoire de Sonia Garel, où elle étudie le rôle des microglies — les cellules immunitaires du cerveau — dans son développement. Sonia Garel est professeure titulaire de la chaire « Neurobiologie et immunité » au Collège de France et dirige l’équipe « Développement et plasticité du cerveau » à l’Institut de biologie de l’École normale supérieure (IBENS). Ses recherches, à l’interface entre neurobiologie et immunologie, portent sur le développement des circuits neuronaux et sur la contribution des microglies à leur formation et leur plasticité.
Ep. 4 : Molécules photosensibles et MOF : les pansements antibactériens
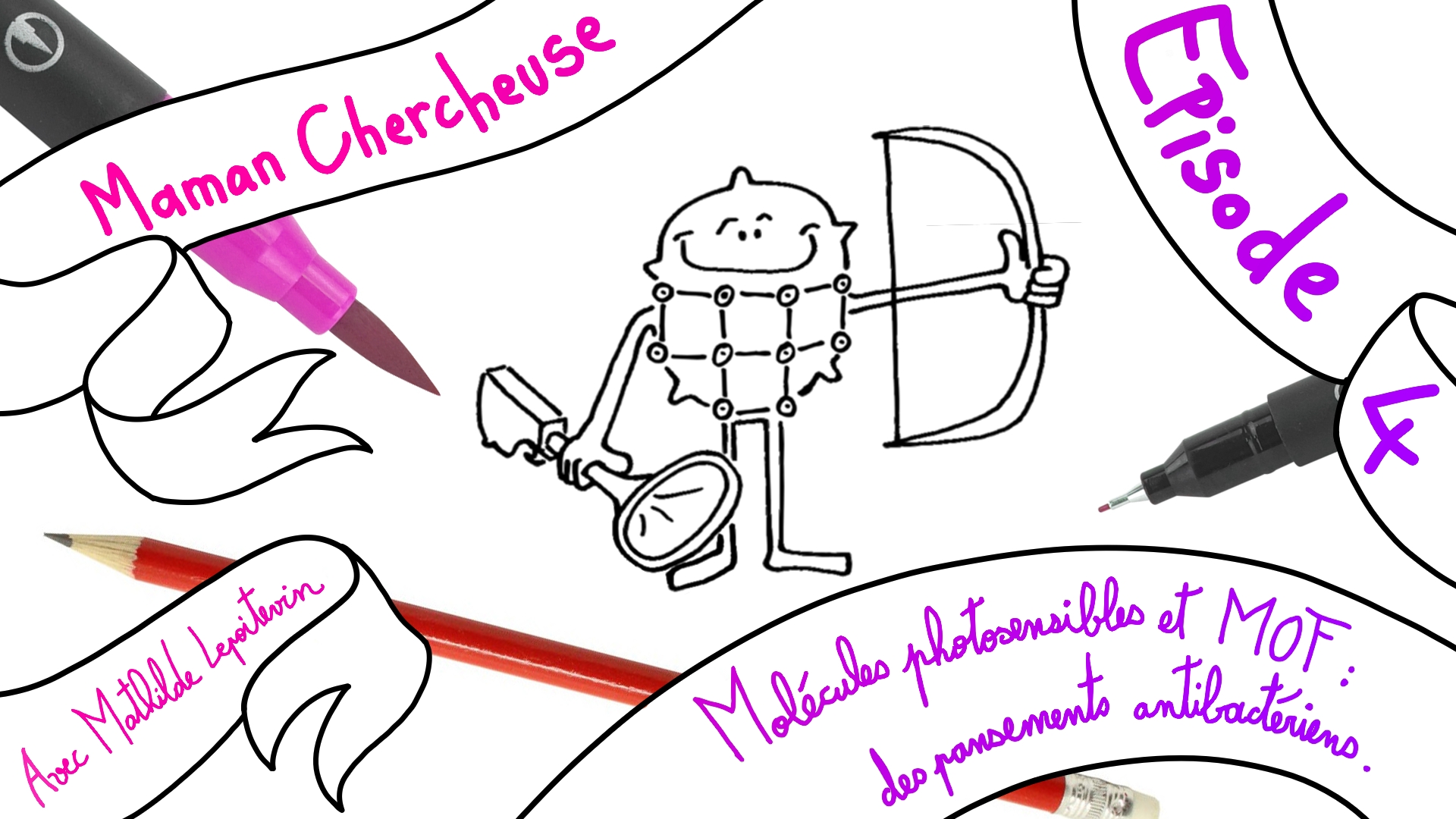
Les molécules photosensibles peuvent détruire les bactéries, sans risque de résistance comme dans le cas des antibiotiques. Pour éviter qu’elles ne s’autodétruisent, on peut enfermer des molécules photosensibles dans une structure poreuse appelée MOF (Metal Organic Framework). Cela permet de créer de super pansements antibactériens.
Mathilde Lepoitevin, ENS-PSL (IMAP)
Mathilde Lepoitevin est maîtresse de conférences au Département de Chimie de l’École Normale Supérieure (ENS-PSL) au sein de l’Institut des Matériaux poreux de Paris (IMAP). Elle travaille dans le domaine de la chimie des matériaux poreux et hybrides, en particulier des Metal Organic Frameworks (MOF). Dans ses recherches, elle développe des nanoparticules de MOF pour des applications bio-médicales, la libération contrôlée de principes actifs et la conception de membranes hybrides.
